La vie du jeune marin
L'équipage (sur le KarrekVen)
rassurée par les souffles des dauphins sauteurs qui m'accompagnent..
(Sylvie, 18 mois à bord)
Courbés sous les rafales, les passants virent, surgissant de la pluie, le Karrek Ven embouquer la passe d'entrée du port encombré, aux commandes d'une bande de gamins de dix à quinze ans, pieds nus. Sans pagaille, sans cris, comme dans un ballet, ces marins s'affairaient, légers, rapides, lovaient des amarres, préparaient des défenses, grimpaient, prêts à bondir, sur la lisse de pavois. Le barreur vira vers le quai rapidement pour ne pas dériver. Ensemble, les défenses basculèrent par-dessus le bastingage pour protéger la coque, plusieurs garçons, bien qu'encore loin, sautèrent sur le débarcadère, des cordages atterrirent à leurs pieds, ils les tournèrent sans hésiter sur des bollards pour stopper le navire, celui-ci se colla au quai, occupant la seule place disponible, sans heurt.
Les passants, stupéfaits, observaient le spectacle. C'était pourtant la procédure normale.
Rencontre, dans les Antilles, d'un autre bateau-école de cette taille. Les jeunes, comme c'est généralement le cas, n'y étaient que la "manœuvre d'appoint" d'une forte structure adulte : un capitaine, un matelot, une personne chargée du "soutien scolaire", une autre de la cuisine et de l'intendance, un cameraman et peut-être un maître-nageur.
Là, les jeunes, comme à l'école, étaient toujours sous la responsabilité et la surveillance d'un adulte. Les interdictions étaient nombreuses : monter dans le gréement, prendre la barque sans adulte, se baigner seul, pisser par-dessus bord sans être harnaché...
L'entretien de ce navire était effectué en chantier par des ouvriers. Les jeunes, eux, éventuellement là encore manœuvre d'appoint, étaient plutôt aux cours, dans le carré.
Impossible, à l'Ecole en Bateau :
- parce que l'aventure était dans cette prise même du bateau par les jeunes,
- parce que l'école était en cela : tout faire, tout assumer.
L'adulte leur laissait donc la place, l'initiative. Il participait à tout, comme n'importe lequel d'entre eux, avec quelques domaines où son âge le mettait plus à même qu'un jeune d'agir : négocier un contrat avec une télévision, veiller au montage d'un film, présenter une demande de fouilles, en diriger le rapport final, déclarer l'entrée du navire aux autorités qui n'auraient pas accepté qu'un "mineur" s'en charge...
L'Ecole fonctionnait de façon permanente, son équipage seulement réduit aux vacances familiales d’été.
(Ages et durée des séjours >>>)
 Le
monde de la mer est encore masculin. Les filles
n'arrivèrent que 5 ans après les débuts de l'Ecole en Bateau, en
moyenne deux pour dix
garçons (le double des
marines occidentales). Quelques unes décrochèrent, se sentant
en minorité, les autres
furent équipières à part entière, comme les garçons.
Le
monde de la mer est encore masculin. Les filles
n'arrivèrent que 5 ans après les débuts de l'Ecole en Bateau, en
moyenne deux pour dix
garçons (le double des
marines occidentales). Quelques unes décrochèrent, se sentant
en minorité, les autres
furent équipières à part entière, comme les garçons.
La vie à bord
Mon copain qui m'avait fait venir ne me l'avait pas montré comme ça...
(Ben, 16 mois à bord)
Ce ne fut jamais un
groupe d'enfants avec horaires et moniteurs.
Ce fut un groupe d'amis, de copains, chacun responsable, effectuant
sa part d'un projet commun.
Sur le Karrek Ven, plus de cabines. Ils abattirent les
cloisons et firent
naître un atelier et un grand carré, lieu de vie et d'étude.
Coucher sur les banquettes, sur le
plancher, sur le pont et, dès l'Amérique, en hamacs.
Toilette, lessive et vaisselle, à l'eau de mer. Chacun s'occupait de son linge.
Le navire était le lieu de vie et de travail d'un groupe en expédition ou recherche. Rien à voir, donc, avec un bateau de loisir pour une sortie en mer.Deux moments distincts et différents : au mouillage (une grande partie du temps, pour pouvoir explorer, fouiller des sites archéologiques) et en navigation (pour le plaisir de naviguer, pour découvrir, ou pour se rendre quelque part).
Au mouillage
- En se levant, on s’inscrivait sur le tableau des tâches : les repas de midi et du soir, les vaisselles de midi et du soir, les nettoyages et les courses.
Ce système simple permettait que ces tâches s'exécutent en leur temps et que seul s'en soucie celui qui s'en était chargé.
- Ce qui prenait beaucoup de temps ! L'entretien du bateau, des voiles, des moteurs, la peinture,
- la re-peinture...
- Et la re-re-peinture, et dérouiller la rouille...
Prenait aussi du temps le traitement des recherches et des expéditions à terre (articles, rapports, montages video).
Certains se spécialisaient (travail du bois, comptabilité, rédaction, photo, travail sur ordinateurs). Ceux qui savaient (généralement les "anciens" et les adultes) enseignaient à ceux qui ne savaient pas encore.
Les projets étaient collectifs (reconstruire la timonerie, fouiller tel site indien juste découvert, réaliser un film, un numéro du magazine du bord, etc.). Pas d'embrigadement, cependant : chacun pouvait trouver sa place suivant ses talents, ses goûts, soit directement dans le projet dont les facettes étaient toujours multiples, soit dans ses à-côtés (logistique, par exemple).
Caréner le Karrek Ven sur un chantier prenait jusqu'à 6 semaines tous les 18 mois. Un temps de travail intense dans une ambiance plutôt enthousiaste, car pour les jeunes, c'était un moment qu'ils n'auraient le plus souvent l'occasion de vivre qu'une fois durant leur séjour.
- Qu'est-ce qu'il est gros ! J'aurais jamais cru !
Caresses et soins au brave compagnon. Chasse aux tarets, les méchants petits vers. Calfatage des fuites. Changement des pièces de bois en mauvais état. Grattage, brossage, peinture...
- T'es beau, maintenant, va !

Explorations à terre, l'équipage se scindait en deux, puis les groupes permutaient.
- On prend les tentes ?
- Evidemment ! Y'en a pour une semaine ! On escalade le Roraima, fait froid, là-haut !
- Si' fait froid, y'a pas d'Indiens !
- Ils vivent en bas, c'est leur montagne sacrée.
- On prend le magnétophone ?
- A ton avis ?
- Pour les légendes, mais tu parles Pémon ?
- On se débrouillera.
Près des lieux de mouillage, les fouilles archéologiques, ou les recherches historiques, ethnologiques
 Expéditions
et recherches,
pouvaient s’accompagner de reportages,
effectués également
par le groupe. Belle occasion de rencontres. Car un navire n'appareille
pas pour rester en mer, mais pour aller voir, de l'autre
côté ! Découvrir,
rencontrer ! C'était, avec les travaux, l'essentiel de
la vie du groupe.
Expéditions
et recherches,
pouvaient s’accompagner de reportages,
effectués également
par le groupe. Belle occasion de rencontres. Car un navire n'appareille
pas pour rester en mer, mais pour aller voir, de l'autre
côté ! Découvrir,
rencontrer ! C'était, avec les travaux, l'essentiel de
la vie du groupe.(Rencontres >>>)
Baignade, exploration sous-marine...
- C'est dans le programme ?
- Le programme, on le fait ensemble, non ?
Les repas étaient conviviaux. Les temps de baignade et de toilette à l'eau de mer, aussi.
Et, souvent, à cinq heures, tea-time !
Au soir, discussions, projets, visionnage de vidéos, et lecture, beaucoup de lecture. Rares furent ceux, même non-lecteurs en arrivant, qui ne s'y mirent pas.
En mer...
... pour explorer une côte, gagner un autre lieu, bien sûr, mais parfois pour le simple plaisir de naviguer, et pour l'aventure car, quitter la terre de vue, c'est toujours se lancer dans l'aventure.
Difficile de travailler en mer. L’atmosphère en était donc souvent vacancière : bains à la traîne du bateau, pêche, lectures, discussions, rêveries, interrompues par des manœuvres qui mobilisaient tout l'équipage.
Ou bien, la lutte avec les vagues, la pluie, le vent quand forcissait la brise. Réduire la voilure sous les paquets de mer, se dépasser, plaisir profond de l'affrontement physique.
Mal de mer ? Le lot du marin... C., cramponné à l'avant du navire, s'offrait en chantant à tue-tête aux déferlantes, pour contrer son malaise.

Navigation de jour, comme de nuit si nécessaire. Les quarts de nuit se prenaient deux par deux, un à la barre, l’autre à la veille et aux calculs nautiques, alternativement durant deux heures.
Naviguer était le grand moment, un moment de vérité. Le temps du marin, de l'aventurier, le temps de l'équipage.
Le navire était beau, sous voiles.
Les travaux du mouillage prenaient alors leur signification.
Il y eut de grandes navigations, comme en mer Rouge ou pour traverser l'Atlantique, remonter l'Orénoque...
Des arrivées étaient magiques : arrivée à New-York, devant la statue de la Liberté ; arrivée aux Antilles, tant rêvées.
A travers cette vie active, chacun apprenait, se découvrait des aptitudes, des talents qui le conduisirent souvent plus tard à une profession en conséquence (marine marchande ou de plaisance, reportage, archéologie, recherche scientifique, monitorat ou enseignement, ébénisterie, artisanat, arts graphiques, informatique).
La majorité des tâches et la navigation nécessitaient la coopération.
En naissait une conscience générale des opérations à effectuer
Transmise des anciens aux nouveaux, cette conscience faisait que chacun savait ce qu'il y avait à faire et s'exécutait sans que des ordres soient nécessaires.
Collaboration, projet collectif, tous dans le même bateau, en somme, mais avec une bonne marge d'indépendance. Chacun y disposait d'une certaine latitude dans l'organisation de son temps et le choix de ses activités. Sauf s'il débutait, personne ne le contrôlait. Ce n'était pas nécessaire.
Ni ouvrier avec contremaître, ni écolier avec professeur; plutôt un artisan, manuel ou intellectuel, voire un créateur.
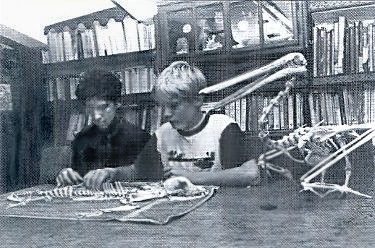
- Mine de rien, ça demandait quand même de se pousser !
(Des indépendants >>>)
Les réalisations au mouillage, l'ingéniosité déployée pour tel travail,
la hardiesse aux manœuvres,
la fierté de mener ce bateau, de s'adonner à des activités généralement fermées à cet âge,
... valorisaient même le plus timoré.
Chacun se sentait un élément important de l’aventure.
Le nouveau-venu, avait fort à faire pour se glisser dans cette peau inimaginable pour un écolier, de marin, de chercheur, de compagnon d'un groupe autonome où l'on attend vite de lui... qu'il sache se débrouiller et contribuer ! Et bien !
Les relations entre les membres du groupe.
Au début ça me manquait, et puis je m'y suis fait, et même ça me plaisait mieux..
(Roger, deux ans à bord)
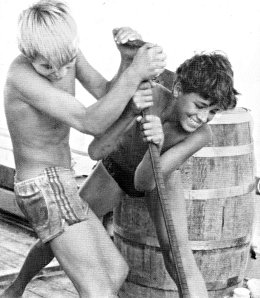
Les relations étaient bonnes, dans l’ensemble, et les agressions physiques quasi inexistantes. La vie active, les responsabilités à assumer, la paix du large ou des mouillages en pleine nature, la coopération, favorisaient ce bon climat relationnel.
Comme dans tout groupe, de petits clans pouvaient se former, des ressentiments se développer, mais chez des jeunes, et dans le feu de l'action, on oublie vite.
Des amitiés naissaient, qui se perpétuent encore aujourd'hui.

C'étaient toujours des jeunes, mais plus des "mineurs", ils exigeaient un traitement à égalité de la part des majeurs qu'ils rencontraient et, généralement, l'obtenaient par leur comportement qui le justifiait.
La coopération amicale, égalitaire, entre les âges (préadolescents, adolescents, jeunes gens) s'étendait tout naturellement à l'adulte qui travaillait avec eux aux mêmes tâches et vivait comme eux.
Cette égalité de statut et de relations entre les âges était annoncée dès la candidature. Bien des jeunes venaient aussi pour cela. Mais elle était tellement normale à bord que personne ne pensait plus à en parler, pas plus que lors les grandes réunions à terre.
D'aucuns auraient pourtant gagné à en débattre, pour préparer leur positionnement au retour, dans une société basée sur les classes d'âges.